Abbaye du Thoronet (Var)

L’abbaye est fondée en 1136, par les moines de Mazan, à Florièges près de Tourtour, puis, à cause de la pauvreté des terres, elle se transporte au Thoronet, domaine plus fertile et verdoyant, dû à la générosité de Raymond Bérenger, comte de Provence.
La construction de l’abbaye s’est déroulée en un seul élan, d’où l’exceptionnelle unité de l’ensemble. Elle est probablement largement entamée en 1176, année d’une nouvelle confirmation des possessions de l’abbaye par le comte de Provence. L’abbaye ne sera jamais très prospère. Elle n’essaime pas et ses tentatives pour annexer d’autres abbayes échouent. Ses effectifs ne semblent pas avoir dépassé 25 moines à la fin du XIIIe siècle.
La construction de l’abbaye s’est déroulée en un seul élan, d’où l’exceptionnelle unité de l’ensemble. Elle est probablement largement entamée en 1176, année d’une nouvelle confirmation des possessions de l’abbaye par le comte de Provence. L’abbaye ne sera jamais très prospère. Elle n’essaime pas et ses tentatives pour annexer d’autres abbayes échouent. Ses effectifs ne semblent pas avoir dépassé 25 moines à la fin du XIIIe siècle.

Jusqu’au milieu du XIIIe
siècle, l’afflux des donations permet à l’abbaye d’organiser son économie
autour de l’agriculture et de l’élevage. L’abbaye se constitue un vaste domaine
foncier, non sans heurts avec les établissements religieux voisins, comme celui
des bénédictines de La Celle.
En 1328, l’abbé du Thoronet, appuyé par les habitants des villages voisins, accuse ses propres moines de participer au brigandage local. A ces conflits s’ajoutent les guerres et la Grande Peste de 1348 qui déciment la population provençale. Les villages sont désertés, les terres abandonnées. En 1416, Mitre Gastinel est nommé à la tête de l’abbaye mais il est accusé de simonie (action d’acheter ou de vendre une chose spirituelle) par un des douze moines du Thoronet. Il restera abbé jusqu’en 1427 mais il semble en effet s’être peu soucié de son abbaye. Son successeur hérite d’un établissement dont les finances sont au plus bas et les bâtiments en mauvais état.
En 1328, l’abbé du Thoronet, appuyé par les habitants des villages voisins, accuse ses propres moines de participer au brigandage local. A ces conflits s’ajoutent les guerres et la Grande Peste de 1348 qui déciment la population provençale. Les villages sont désertés, les terres abandonnées. En 1416, Mitre Gastinel est nommé à la tête de l’abbaye mais il est accusé de simonie (action d’acheter ou de vendre une chose spirituelle) par un des douze moines du Thoronet. Il restera abbé jusqu’en 1427 mais il semble en effet s’être peu soucié de son abbaye. Son successeur hérite d’un établissement dont les finances sont au plus bas et les bâtiments en mauvais état.

En 1435, l’abbaye tombe en
commende, ce ne sont pus les moines de l’abbaye mais les papes d’Avignon qui
nomment les abbés. A partir du XVe siècle, le roi la dispute au pape pour des
raisons à la fois politiques et financières. Le système de la commende est
officialisé en 1516 par le concordat de Bologne, par lequel le pape Léon X
confère à François 1er le droit de nommer les titulaires
ecclésiastiques. La charge d’abbé est désormais un bénéfice affecté à un
dignitaire qui gère le monastère et en perçoit une partie des revenus sans être
tenu d’y résider.
A compter du XVIe siècle les abbés commendataires se succèdent, plus ou moins sensibles au sort des bâtiments. A la fin du XVIe siècle, lors des troubles protestants, l’abbaye aurait été abandonnée quelque temps. Au cours du XVIIe siècle, une série de désaccords oppose les moines à leur abbé, qui refuse de procéder aux réparations demandées. L’abbatiale sert alors d’église paroissiale.
A compter du XVIe siècle les abbés commendataires se succèdent, plus ou moins sensibles au sort des bâtiments. A la fin du XVIe siècle, lors des troubles protestants, l’abbaye aurait été abandonnée quelque temps. Au cours du XVIIe siècle, une série de désaccords oppose les moines à leur abbé, qui refuse de procéder aux réparations demandées. L’abbatiale sert alors d’église paroissiale.
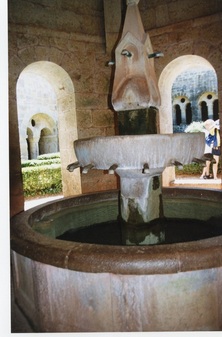
Le rapport d’un économe de
la seconde moitié du XVIIIe siècle décrit une existence relativement luxueuse,
en accord avec le mode de vie des Cisterciens d’alors. Une partie d’entre eux a,
en effet, refusé de suivre la réforme proposée un peu plus tôt au monastère de
la Trappe par l’abbé Rancé, qui est à l’origine de la scission de l’Ordre en
deux obédiences : la commune observance et la stricte observance.
La communauté étant très endettée, monseigneur de Flamarens, dernier abbé commendataire et vicaire général de Bourges, dresse un acte de faillite en 1785. Quand sa sécularisation est décidée, en 1785, l’abbaye du Thoronet est placée sous la dépendance du roi puis affermée par un bail de six ans à Jacques Clément Blond, entrepreneur et fournisseur de grandes gabelles.
La communauté étant très endettée, monseigneur de Flamarens, dernier abbé commendataire et vicaire général de Bourges, dresse un acte de faillite en 1785. Quand sa sécularisation est décidée, en 1785, l’abbaye du Thoronet est placée sous la dépendance du roi puis affermée par un bail de six ans à Jacques Clément Blond, entrepreneur et fournisseur de grandes gabelles.

Le 1er janvier
1791, les sept derniers moines de l’abbaye sont placés dans d’autres maisons
religieuses. La vente de l’abbaye comme bien national est annoncée le 28 mai
1791. Une partie de l’abbaye étant estimée comme « trésor d’art et
d’histoire » reste propriété de la nation. L’autre partie est vendue le 17
mars 1793. Les nouveaux propriétaires et les communes voisines utilisent les
pierres de certains des bâtiments pour leurs propres constructions.
Dès 1840, l’abbaye est classée monument historique. C’est le début de nombreuses restaurations.
Dès 1840, l’abbaye est classée monument historique. C’est le début de nombreuses restaurations.
